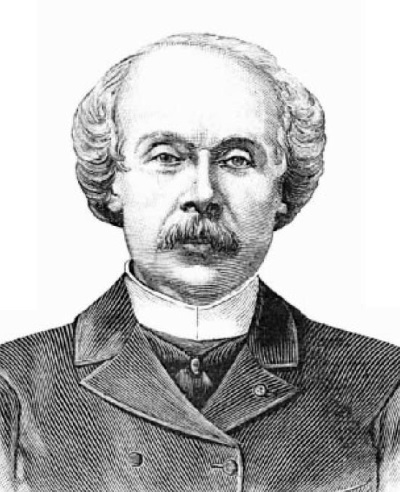L’Honneur de ma fille (Adolphe D’ENNERY)
Drame en trois actes.
Représenté pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre de l’Ambigu-Comique, le 17 décembre 1835.
Personnages
LEBRUN, maître de forges
JENNY, sa femme
GADICHET, apprenti
MAURICE (ÉDOUARD)
LE DOCTEUR MURRAI
PETERSON, magistrat anglais
JEAN BUDAN, ouvrier
LA PETITE FILLE de Lebrun
UNE BONNE
PREMIER GARDIEN
DEUXIÈME GARDIEN
UNE SERVANTE
OUVRIERS
FEMMES d’ouvriers
GARDIENS
GARDES du constable
CHEFS D’ATELIER
La scène se passe à Paris, au premier acte ; et à Londres, au troisième.
ACTE I
Une grande salle, proprement meublée, sans élégance ; au fond, les ateliers de M. Lebrun.
Scène première
JENNY, MAURICE
Maurice tient sa casquette à la main, il a l’air consterné ; ses traits sont pâles.
JENNY.
Sortez, monsieur, sortez ; je vous l’ordonne.
MAURICE.
Madame, au nom du ciel, daignez m’entendre ! Je voudrais partir emportant avec moi un autre souvenir que celui de votre colère.
JENNY.
Pas un mot de plus, monsieur ! je vous le répète, votre présence est un supplice pour moi : sortez, ou j’appelle, et je vous fais chasser.
MAURICE.
Oh ! c’est trop de cruauté, madame ! c’est donc plus que du dédain, de la colère, de la haine... c’est du mépris que je vous inspire !...
JENNY.
Eh bien ! oui, vous l’avez dit ; c’est du mépris, et maintenant sortez ; et si vous gardez au fond de l’âme le sentiment de quelque honneur, ne vous offrez jamais aux yeux d’une femme que avez si lâchement outragée ; songez que vous avez appelé tous les malheurs sur sa tête !... Allez.
MAURICE
M. Lebrun m’a reçu dans ses ateliers comme premier ouvrier ; je ne puis avant son retour, déserter la responsabilité que j’ai prise.
JENNY.
Eh bien, sachez donc que mon mari est de retour.
MAURICE.
De retour ! mais son absence devait se prolonger encore...
JENNY.
Quelle que soit la cause de son arrivée, je ne veux pas supporter plus longtemps votre présence ; elle serait un outrage pour lui... Seule, j’aurai peut-être le courage de dévorer ma honte et de refouler mes larmes... mais devant vous, monsieur, je me perdrais : mon trouble, ma pâleur n’échapperaient pas à son regard... Encore une fois, monsieur, n’oubliez pas que vous avez un crime à expier ; n’oubliez pas que, par violence, vous avez arraché une femme à ses devoirs sacrés d’épouse et de mère... Par grâce, n’achevez pas votre victime, eu attirant sur elle la haine et le mépris du seul homme qu’elle ait jamais aimé !...
MAURICE.
Je le sais, madame, mon crime fut grand ; mais n’y a-t-il pas de pitié pour celui qui a vainement combattu sa fatale passion ?
JENNY.
De la pitié pour une passion qui s’assouvît lâchement au milieu d’une nuit d’horreur, malgré les larmes, les prières et le désespoir d’une victime isolée, sans défense !... non, non, je n’en ai point. Je vous l’ai dit, haine et mépris pour vous !
MAURICE.
Vous vous trompez sur le motif de mon crime : depuis longtemps je vous aimais.
JENNY.
Vous m’aimiez !...
MAURICE.
Oui, madame, depuis longtemps... Pauvre, orphelin, sans fortune, je ne pouvais me présenter à votre famille et demander votre main ; il fallait renfermer mon amour au fond de mon cœur ; mais bientôt cet amour augmenta de toute la force que donnent la jalousie et le malheur, car alors un autre se présenta, et cet autre devint votre époux : cela était juste, parce qu’il était riche, lui !...
JENNY.
Dites, parce que je l’aimais.
MAURICE.
Moi, je n’avais au monde qu’un seul ami, qu’un protecteur, le docteur Murray.
JENNY.
Le docteur Murray !
MAURICE.
Lui seul s’intéressait à moi ; et lorsqu’il me pressa sur le choix d’un état, lorsque chaque carrière s’ouvrait à moi avec ses espérances de succès, mon fatal amour me fit tout refuser, et la fortune que donne le commerce, et la glorieuse auréole du champ de bataille, et les triomphes du barreau... Je veux être forgeron, lui dis-je... Il ne me crut pas d’abord, mais sur mes instances réitérées, il consentit ; et des que je fus assez ha bile dans cette carrière, je quittai la maison où il m’avait placé, et, profitant de l’absence du docteur, je me présentai ici.
JENNY.
Oh ! c’était un plan habilement conçu !...
MAURICE.
Dieu m’est témoin qu’alors je ne voulais que vous voir, respirer le même air que vous : mais depuis !...
JENNY.
Depuis, monsieur, savez-vous quelle existence vous m’avez faite ?... Il me semble que je porte au front un signe honteux qui attire tous les regards, et des regards de mépris !... Le nom de mon époux qu’on prononce en ma présence est une torture pour moi... sa vue, sa vue, me tuera peut-être... et ma fille, mon enfant, je tremble lorsqu’elle m’appelle sa mère ; chacune de ses caresses est une souffrance ; ses baisers me glacent d’effroi, je n’ose plus la serrer sur mon cœur !... Oh ! vous m’avez rendue bien misérable !... Ma fille !... je n’ose plus embrasser ma fille !
MAURICE.
Jenny, croyez à mon repentir, à mes remords. Je voudrais, fût-ce au prix de ma vie, obtenir mon pardon.
On entend le son d’une cloche.
JENNY.
On vient, monsieur, je me retire. Songez à partir aujourd’hui, aujourd’hui même.
Elle sort.
Scène II
MAURICE, GADICHET, JEAN BUDAN, PLUSIEURS OUVRIERS
BUDAN.
Allons, il est deux heures.
GADICHET.
Et c’est l’heure du potage, la plus belle heure du jour.
BUDAN.
Il était temps que le moment du repos nous arrive, je suis rompu. Chien de métier !
GADICHET.
Bon ! v’là comme tu parles de ton art, toi !
BUDAN.
Ah ! un art... forgeron !... il appelle ça un art, dis donc, Maurice !
MAURICE.
Ah ! laissez-moi !
GADICHET.
Certainement ! un art inventé par le grand Saint-Éloi, encore !
BUDAN.
N’es-tu pas bien payé pour défendre ce que tu lu appelles ton art, toi qui, l’année passée, as reçu un grand coup de marteau sur la tête !
GADICHET.
C’est vrai que ça m’a un peu refroidi ; je voulais d’abord y renoncer, mais après, je me suis raisonné ; je me suis dit : dans tous les métiers у a des dangers ; j’ai eu la tête fêlée pour apprendre à être forgeron ; mais j’aurais peut-être autre chose de cassé pour apprendre à être gouverne ment !
BUDAN.
Mais allons, en route ! le temps passe.
TOUS.
Oui... à la soupe !... à la soupe !
GADICHET.
Un instant ! j’ai quelque chose à vous proposer.
MAURICE.
Allons, qu’est-ce encore ?
GADICHET.
Toi, monsieur le difficile, si ça te jugule, tu peux t’en aller.
MAURICE.
Il s’agit sans doute de quelque partie de cabaret, je vous souhaite bien du plaisir ; adieu !
Il sort.
Scène III
GADICHET, JEAN BUDAN, PLUSIEURS OUVRIERS
GADICHET.
Bon ! je suis bien aise qu’il s’en aille ; je ne peux pas le digérer. BUDAN.
Pourquoi ça ?
GADICHET.
Pourquoi ?... parce que je crois que c’est pas un honnête homme.
BUDAN.
Comment ça ?
GADICHET.
D’abord, il n’boit, ni ne fume, la pipe est sans charme à ses yeux ; il fait sa barbe tous les jours, il porte des faux cols et il change de linge deux fois par semaine : or, un homme qui fait sa barbe tous les jours, qui porte des faux cols et qu’a l’moyen de changer de linge deux fois par semaine, ça n’peut pas être un honnête homme.
BUDAN.
Bah ! bah !... au fait, qu’as-tu à nous proposer ?
GADICHET.
Voilà la chose... Au lieu de dîner chez notre voisin le fricoteur, je vous offre un dîner soigné, un dîner de commissionnaire au Mont de Piété ; ça va-t-il ?
BUDAN.
Comment ?
GADICHET.
Je vous offre le dîner du patron qui revient aujourd’hui de son voyage, et ça remplacera joliment le potage sans viande et le lapin de gouttière.
BUDAN.
Mais le moyen de nous faire inviter ?
GADICHET.
Voilà : du 25 fleuréal an 3 au 25 fleuréal an 4, combien que ça fait ?
BUDAN.
Ça fait un an.
GADICHET.
Bien ! Jean Budan... tu connais les mathématiques. Or, il y a juste un an aujourd’hui que l’on célébrait, pour la huitième fois, l’anniversaire du mariage du patron.
BUDAN.
C’est vrai ! у neuf ans qu’ils sont mariés.
GADICHET.
Eh bien, en avant les bouquets et la veste des décadis, et le bourgeois ne peut pas se dispenser de nous inviter.
TOUS.
Bravo !... bravo !...
GADICHET.
D’ailleurs, ce sera une bonne chose pour le citoyen patron, qui depuis quelque temps, de joyeux et réjoui comme il était, est devenu triste comme un réverbère.
BUDAN.
C’est ça !... nous l’égaierons.
GADICHET.
Et alors, noce indéfinie ! nous aurons les meilleures choses possibles : du saucisson de Lyon, et du vin des quatre parties du monde, y compris ce lui d’Argenteuil.
TOUS.
Adopté !... adopté !
GADICHET.
Allons-nous nous en taper... je vous donnerai l’exemple.
BUDAN.
Tu sais que le docteur t’a défendu de boire, ça te jouera un mauvais tour ; il dit qu’avec ton coup de marteau sur la tête, ça peut le rendre fou...
GADICHET.
Laisse donc, il disait ça un jour en dînant chez le patron, vu que j’étais placé à côté de lui et qu’il aimait mieux que je lui verse, que de me verser à moi même... c’est une banque !...
BUDAN.
Oh ! il le disait sérieusement.
GADICHET.
Bah !... tu connais pas les médecins ; c’est encore un autre art étonnant... Sais-tu ce que ça fait, un médecin ?
BUDAN.
Dam ! ça guérit...
GADICHET.
Au contraire !
BUDAN.
Bah ! vraiment ?...
GADICHET.
Tiens, toi Jean Budan, un supposé : t’est une vieille femme, par exemple !
BUDAN.
Du tout, je ne veux pas...
GADICHET.
Mais laisse-toi faire, Jean Budan ! ça ne t’ôte rien de tes avantages extérieurs ; c’est une supposition, ça ne t’empêche pas de monter ta garde et payer les contributions...
BUDAN.
À la bonne heure !
GADICHET.
Ainsi t’est une vieille femme, veuve de trois maris qui t’ont laissé chacun des petites rentes ; tu fais la pot-bouille, et comme t’es délicate, tu mets dans ton pot une aile ou une cuisse de quel que chose, pas vrai ?
BUDAN.
Oui, à mon choix...
GADICHET.
Le docteur arrive, y se met à table avec toi, et y le dit, « Mère Jean Budan, faut pas manger de ça, ça vous échauffe ; » alors il se l’offre à lui même : « faut pas manger de l’autre, ça vous ra froidit ; » y se trouve que lui a besoin de se rafroidir, et finalement il se repasse tout ce que t’as de bon, de peur que tu ne te fasses du mal ; c’est comme qui dirait un gouvernement qui te prendrait tout ce que t’as pour empêcher qu’on ne te vole. C’est encore une banque.
On entend le roulement d’une voiture.
BUDAN.
Une chaise de poste !...
GADICHET.
C’est le citoyen patron qui arrive. Attention, et de l’enthousiasme !
Scène IV
GADICHET, JEAN BUDAN, PLUSIEURS OUVRIERS, LEBRUN, entrant par la droite, et JENNY, par la gauche, tenant sa fille par la main
TOUS.
Vive le citoyen patron !
LEBRUN.
Bonjour, bonjour, mes amis !
GADICHET.
Serviteur, patron, vous avez fait un bon voyage ?
LEBRUN.
Oui... oui... je vous remercie... Ah ! ma fille, ma Sophie !
Il la prend dans ses bras et l’embrasse.
SOPHIE.
Cher papa, que j’étais malheureuse de ne pas te voir !
LEBRUN.
Cher enfant !...
SOPHIE.
Mais te voilà de retour, et tu ne nous quitteras plus...
LEBRUN.
Non, je l’espère.
BUDAN.
Tiens ! il n’embrasse pas sa femme !
GADICHET.
C’est p’t-être qu’il n’ose pas devant nous !
LEBRUN.
Madame, rien de fâcheux, je pense, vous est arrivé depuis mon départ ?
JENNY.
Non, mon ami... non, monsieur...
Bas.
Cet air glacé, cette sévérité de regards et de paroles... que penser, mon dieu !
LEBRUN.
Mes amis, après un voyage de plusieurs jours, j’ai besoin de repos ; plus tard je vous reverrai, j’inspecterai vos travaux.
GADICHET.
Et vous en serez content, patron ; seulement vous pourrez guères inspecter les miens, vu que je ne fais que tirer le soufflet.
LEBRUN.
D’ailleurs, il ne semble que c’est l’heure du dîner.
GADICHET.
Oui, patron ; et on y va...
Bas à J. Budan.
Faut nous entendre avec la bourgeoise pour l’anniversaire en question !...
Ils sortent tous.
LEBRUN.
Allez, mes amis, allez... Madame, emmenez votre fille, je veux être seul.
GADICHET.
Serviteur. bourgeois, sans oublier votre famille.
Jenny sort avec sa fille.
Scène V
LEBRUN, seul
Enfin... la présence des autres m’est insupportable ; il me semble toujours que ceux qui m’entourent lisent dans mes yeux mes tortures et mon déshonneur... Ma fille, ma Sophie... il faut tout l’amour d’un père pour me forcer au silence... et cette femme, comme elle m’a lâchement trompé !... Insensé qui, le jour de mon mariage, prenais pour de l’amour la joie ou l’orgueil que lui don nait la fortune dont je l’entourais !... Il y a un mois encore, j’étais heureux... j’ignorais... et voilà que cette lettre fatale est venue m’enlever tout mon bonheur en me révélant ma honte... de puis que je l’ai trouvée, elle reste là sur ma poitrine, pour me déchirer.
Il prend la lettre.
Deux initiales seulement un E. et un D... je ne sais à quel nom appliquer ces deux fatales lettres... Sur un simple soupçon, j’ai pris la poste, couru à plus de cent lieues d’ici, je suis arrivé comme un forcené chez un de mes amis ; ce ne pouvait être lui, il n’y avait que huit jours qu’il était de retour en France... Cette femme... un instant j’ai eu la pensée de l’accuser en face, de la forcer de parler, de lui arracher le nom de son complice ; mais je suis père... et puis, ce serait un scandale dont le ridicule et la honte retomberaient sur moi... Oh ! ce nom, ce nom, je donnerais la moitié de ma vie pour le connaître, car alors ma vengeance, pour être silencieuse, n’en serait pas moins terrible ; je pourrais venger mon honneur, sans laisser en dot à ma fille la honte de sa mère... Mais souffrir en silence les tourments de l’opprobre et de la jalousie... être condamné à cacher dans son cœur un secret qui ronge et détruit, quel supplice !... quel supplice, mon dieu !...
Scène VI
LEBRUN, MURRAI
MURRAI.
Bonjour, mon cher Lebrun !
LEBRUN.
Ah ! c’est vous, docteur !
MURRAI.
J’arrive de voyage en même temps que vous ; il paraît que nos deux chaises se suivaient... mais auriez-vous été malade ? depuis trois mois que je ne vous ai vu, vous êtes bien changé.
LEBRUN.
Oh ! ce n’est rien, je vous assure... quelques nuits passées en voiture, une fatigue qu’on peu de repos fera bientôt oublier... Mais, vous-même, êtes-vous content de votre voyage ?
MURRAI.
Non, en revenant des eaux, j’ai voulu visiter un jeune homme qui avait été confié à ma tutelle ; je l’avais placé dans une ville voisine, et j’ai été péniblement surpris en apprenant qu’il avait quitté cette maison, sans indiquer le lieu de sa nouvelle résidence.
LEBRUN.
À propos !... depuis votre départ, j’ai accueilli chez moi un jeune ouvrier auquel vous avez donné vos soins pendant une longue maladie.
MURRAI.
Un ouvrier !... et son nom ?
LEBRUN.
Maurice.
MURRAI.
Maurice !... je ne me souviens pas...
LEBRUN.
Vous le trouverez dans l’atelier.
MURRAI.
Je serais bien aise de le voir... À propos, je dine avec vous...
LEBRUN.
C’est convenu, docteur !
MURRAI, sortant.
Maurice !... c’est singulier !...
Il sort par la droite, Jenny entre par la gauche.
Scène VII
LEBRUN, JENNY
LEBRUN.
C’est elle ! que peut-elle me vouloir ?
JENNY.
Monsieur... je vous cherchais.
LEBRUN.
Qu’avez-vous à me dire, madame ?
JENNY, à part.
Mon dieu ! comme je tremble.
LEBRUN.
Eh bien... madame ?
JENNY.
Je venais vous dire qu’aujourd’hui...
LEBRUN.
Aujourd’hui ?...
JENNY.
C’est l’anniversaire de notre mariage...
LEBRUN.
Vous vous en êtes souvenue ?
JENNY.
Vos ouvriers sont venus me trouver... pour me rappeler que ce jour-là...
LEBRUN.
Ah !... oui... un dîner... une fête !...
JENNY.
Je voulais savoir si aujourd’hui vous désirez que cela ait lieu ?
LEBRUN.
Si je le désire !... si je le désire, madame !... mais cela n’est-il pas naturel ?... ce jour n’a-t-il pas été le plus beau de ma vie ? Ce jour-là, ma joie, mon ravissement éclataient dans chacun de mes gestes, dans chacune de mes paroles ; vous même me disiez : Mon ami, je ne serais pas heureuse de cette union, que le bonheur qu’elle vous cause suffirait pour me la rendre chère... vous le rappelez-vous, Jenny ?
JENNY.
Oui, monsieur, je me le rappelle.
LEBRUN, avec une ironie concentrée.
Et depuis... cette union n’a-t-elle pas toujours été bénie ? n’ai-je pas toujours trouvé en vous une épouse tendre et soumise, se souvenant de ses serments d’amour et de fidélité ? une épouse attentive, épiant mes désirs, comme j’épiais les siens, dont la tendresse et le dévouement égalaient les miens ; une femme enfin qui tenait en dépôt sacré l’honneur de son mari, dont la seule ambition était son bonheur !... Et vous demandez si je veux qu’on célèbre l’anniversaire de mon mariage !... oh ! mais ce serait une injure que d’en douter... car si je ne le voulais pas, je serais un insensé, n’est-ce pas, madame ?
JENNY.
Il y a dans votre voix, dans vos paroles un air de cruelle ironie qui m’effraie... et je ne sais encore si je vous ai bien compris... Si vous désirez en effet que cette célébration ait lieu...
LEBRUN, avec force.
Oui, je le veux pour mon honneur, pour celui de ma fille !...
Il sort.
Scène VIII
JENNY, puis MAURICE
JENNY, seule.
Pour son honneur !... pour celui de sa fille !... oui, c’est pour son honneur seulement qu’il affecte encore avec moi cet air de déférence qu’il prend devant le monde... Mon dieu ! il a donc lu ma honte sur mon visage !... le feu sombre de ses regards, le son de sa voix, tout cela m’épouvante : il y a des moments où je me sens prête à lui demander grâce et à lui tout avouer.
MAURICE, accourant.
Ah ! madame !... il faut que je vous parle !...
JENNY.
Laissez-moi, laissez--moi, monsieur !...
MAURICE.
Mais un grand malheur nous menace.
JENNY.
Un malheur, dites-vous ! le plus grand de tous est d’être indigne de porter le nom d’épouse et de mère ; après celui-là, monsieur, il n’en est plus qu’une femme ait à redouter.
Elle sort.
Scène IX
MAURICE, puis MURRAI et GADICHET
MAURICE.
Elle n’a pas voulu m’entendre !... et le docteur qui vient d’arriver, qui peut nous perdre !... il ne le fera pas, je l’espère... Je ne sais ce qui motive l’intérêt et l’affection qui l’attachent à moi, mais il exerce sur moi une influence que je ne puis comprendre... Le voici, il n’est pas seul... tâchons d’éviter la surprise que lui causerait ma vue.
Gadichet et le docteur entrent par la gauche.
GADICHET.
Oui, respectable docteur, nous causions de vous à l’atelier ce matin ; et votre éloge était de dans ma bouche de même qu’elle est dedans mon cœur.
MURRAI.
Et vôtre tête ?... ce coup de marteau vous fait il encore souffrir ?
GADICHET.
Du tout, docteur ; seulement il y a des fois, les fêtes particulièrement.
MURRAI.
Oui, parce que ces jours-là vous oubliez ma recommandation, vous buvez... Je vous le répète, ça vous jouera un mauvais tour.
GADICHET.
Eh bien ! foi de Gadichet, docteur, ça ne m’ar rivera plus... excepté aujourd’hui pourtant.
MURRAI.
Comment ?...
GADICHET.
Oui, nous célébrons l’anniversaire du mariage du patron ; et comme c’est lui qui m’a procuré ma fêlure, si je ne buvais pas, ça lui rappellerait la chose, ça lui ferait de la peine.
MURRAI.
C’est pour lui seulement que vous voulez boire ?
GADICHET.
Uniquement, savant docteur.
MURRAI.
Dites-moi quel est celui de vos camarades qu’on nomme Maurice.
GADICHET.
Le cafard !...
À part.
Tiens, y s’connaissent !...
Haut.
Eh ! tenez ! le voilà qui rumine dans son coin.
MURRAI.
Ah !... j’ai à lui parler.
GADICHET.
N’vous gênez pas ! Moi, j’suis chargé de mettre le couvert, et justement v’là qu’on vient m’aider.
MURRAI, s’approchant de Maurice.
C’est vous !... je m’en doutais.
MAURICE.
Silence, docteur !
MURRAI.
Pourquoi êtes-vous dans cette maison, sous cet habit ?
MAURICE.
Je vous dirai tout ; mais au nom du ciel, monsieur, silence !... ne me perdez pas !
Il l’entraîne dans le fond et ils causent bas ; pendant ce temps, Gadichet, aidé de la bonne et de deux ouvriers, continue de mettre le couvert ; ils apportent la table toute servie et la placent à la gauche de l’acteur.
GADICHET.
Ah !... ils se connaissent !... eh bien ! c’est drôle, tout de même... les deux hommes que je hais le plus au monde... Et le citoyen patron qui n’veut pas m’écouter quand je lui dis que le cafard a les mains blanches ; chaque fois il les lave, ce qui n’est pas naturel du tout... Et quand je lui dis qu’il reçoit des lettres sur papier bleu... jaune... blanc... tricolore... Eh bien, je coulerai ça à fond... j’en ai deux que j’ai trouvées... je vais m’en occuper.
Il sort.
Scène X
MAURICE, MURRAI
Ils reviennent sur le devant de la scène.
MURRAI.
Je vous le répète, il faut qu’aujourd’hui même vous quittiez cette maison.
MAURICE.
Aujourd’hui ?
MURRAI.
Oui, je devine quel motif vous a fait changer de nom et vous a conduit ici... Et je dois m’opposer...
MAURICE.
Mais, monsieur, que vous importe, après tout ?...
MURRAI.
Et que m’importent aussi la vie et le repos d’un homme, l’honneur ou l’opprobre de sa maison, n’est-ce pas ?... Cet homme est mon ami ; entre lui et votre passion, je n’hésiterai pas... Vous partirez aujourd’hui !...
MAURICE.
Et de quel droit me donnez-vous des ordres ?
MURRAI.
De quel droit ?... Mon droit est dans votre secret, que je possède, et dans mes bienfaits, qui ne se sont jamais démentis.
MAURICE.
Mais cette femme, c’est ma vie ; la voir est mon seul bonheur !
MURRAI.
Jusqu’à ce que votre amour pour une autre vous l’ait fait oublier... Vous quillerez cet état, je le veux ; vous retournerez dans le monde, et, là, vous trouverez assez de femmes qui accueilleront vos hommages, et, cela, sans que vous brisiez les liens d’une famille, et flétrissiez le nom d’un ami.
MAURICE.
N’importe !... Je ne partirai pas !
MURRAI.
Vous partirez ce soir !
Scène XI
MAURICE, MURRAI, JENNY, SA FILLE, GADICHET, LES OUVRIERS, PLUSIEURS INVITÉS
LEBRUN.
Mes amis, je vous remercie de l’intérêt que vous me portez ; c’est une marque d’estime qui m’est précieuse, parce qu’elle me vient de braves et honnêtes gens. Allons, mes amis, à table.
TOUS.
À table ! à table !
GADICHET.
Ah ! y s’ met à not’ table, le cafard... j’ vas joliment l’ faire déguerpir.
MURRAI.
Et soyons gais !... c’est un beau jour...
À Lebrun.
Allons, mon ami, quittez donc votre air triste ! À votre santé !
TOUS.
À la santé du patron !
MURRAI.
Eh bien ! mais, Gadichet, je vous avais permis de boire aujourd’hui...
GADICHET.
C’est justement pour ça que je ne bois pas !
À part.
D’ailleurs, j’ai mon idée.
MURRAI.
Comment ?...
GADICHET.
Ça me tentait avant, vu que ça m’était défendu... mais maintenant que c’est autorisé, je ne m’en soucie pas !
MURRAI, à Lebrun.
Tenez, mon ami, voilà que vous vous laissez encore aller à votre rêverie !
LEBRUN.
Mais, non, non... vous vous trompez, docteur... Versez-moi à boire.
MURRAI.
Allons, un toast à notre jolie petite Sophie !
TOUS.
Oui, à sa santé !
LEBRUN.
À ma fille !... Merci... merci, mes amis.
Il boit.
GADICHET.
Diable !... le patron boit bien souvent... J’ai pourtant besoin de lui.
Pendant toute cette scène, Lebrun semble de nouveau absorbé par ses réflexions ; quelquefois on dirait qu’il se parle à lui-même.
MURRAI.
Allons, une chanson pour égayer le repas !
GADICHET.
Eh bien ! mais, le citoyen Maurice roucoulera une romance...
MAURICE.
Moi ?...
GADICHET.
Quand on porte des gants et qu’on reçoit des lettres parfumées...
MAURICE.
Des lettres parfumées ?...
GADICHET.
Un peu !... nous les avons senties ; pas vrai, Jean Budan ?
BUDAN.
C’est vrai !
MURRAI.
Diable !
LEBRUN.
Allons, Gadichet, en voilà assez !
GADICHET.
Excusez, patron ; mais je peux pas me retenir, ça m’étouffe !... D’ailleurs, faut plus qu’il nous en fasse accroire ; tu n’es pas ouvrier ; c’est pas à un ouvrier qu’on écrit : « J’ai bien l’honneur, avec lequel je suis respectueusement, etc. etc... »
MAURICE.
Malheureux !... avoir osé soustraire mes lettres !
GADICHET.
Soustraire !... qu’appelles-tu, soustraire ?... on les a prises, à la bonne heure !
MAURICE.
Quel qu’il soit, celui-là me rendra raison !
GADICHET.
Raison ! tu dis raison, et tu prétends que t’est un ouvrier ; l’ouvrier s’aligne et il ne demande pas raison, eh ! melon !...
LEBRUN.
Allons, assez !... assez ! Cesseras-tu les suppositions ?
GADICHET.
Des suppositions !... ça n’en est plus... Si c’est un ouvrier, pourquoi qu’il a changé de nom ?
LEBRUN.
Changé de nom ?
MAURICE.
Silence, encore une fois !
GADICHET.
Oh ! l’as beau faire les gros yeux, je ne te crains pas... Oui, t’as changé de nom, puisqu’on l’écrit : « Au citoillien, citoillien Édouard d’Harcourt. »
LEBRUN, sortant tout-à-fait de sa rêverie, et se levant.
Édouard d’Harcourt !... Les deux initiales... Quel est ce nom que tu as prononcé ?
GADICHET.
Eh bien, le sien, donc !
LEBRUN.
Le sien !... Cela est-il bien vrai ? Parle donc, parle donc !
GADICHET.
Parbleu !... demandez-lui plutôt au cafard !
LEBRUN, s’approchant de lui et le regardant en face.
Toi !... Mais, en effet... tes manières, ton langage ne sont pas ceux de mes autres ouvriers... Tu es venu chez moi, vivre sous mon toit, manger à ma table, tout cela sous un faux nom ; et tu te nommes Édouard d’Harcourt... Oh ! la lettre !... la lettre !...
JENNY.
Mais, monsieur...
LEBRUN.
Voulez-vous demander grâce pour lui ?
MURRAI.
Votre raison s’égare !
JENNY.
Il sait tout ; je suis perdue !
LEBRUN.
Ah ! ce n’était pas assez de mon déshonneur, n’est-ce pas ?... il fallait y mettre le comble en l’accomplissant jusques dans ma propre maison !
MAURICE.
Monsieur, j’ignore...
LEBRUN.
Infâme !... Oh ! mais il ne faut ion sang pour laver mon honneur !...
Il saisit un couteau et veut s’élancer sur lui.
MURRAI.
Arrêtez-le !... c’est du délire... de la folie !
LEBRUN, à ceux qui le retiennent.
Laissez-moi !... laissez-moi !... Jusqu’à ce jour, j’ai pu dévorer ma honte pour sauver l’honneur de ma fille... mais, maintenant, il faut qu’elle éclate ; il faut que je me venge !
MURRAI.
Au nom du ciel ! ne le lâchez pas !
LEBRUN, à ceux qui le retiennent.
Oh ! laissez-moi, laissez-moi donc ! mais vous n’avez donc pas de femme ou de fille, vous qui voulez que je vive couvert d’opprobre et de honte, vous qui permettez que le misérable ose me braver en face, sans que je le tue !... Oh ! c’est infâme !... c’est infâme !...
Il tombe évanoui sur une chaise.
MURRAI.
Que tout le monde s’éloigne ; comme médecin je l’ordonne. Une fatale maladie s’était emparée de lui depuis un mois, et maintenant il est fou !
TOUS.
Ah !...
GADICHET.
Plus souvent !
MURRAI.
Sortez ! dans un instant vous pourrez vous en convaincre !
JENNY.
Quoi, docteur, le quitter dans un pareil mo ment ! non, non, c’est impossible !
MURRAI.
Il le faut, madame, il le faut ! Emmenez cet enfant.
Tout le monde sort.
Scène XII
MURRAI, LEBRUN
MURRAI.
Allons, du sang-froid !... Il faut les sauver tous les deux.
LEBRUN, revenant à lui.
Murrai !... vous, ici, seul, près de moi ?
MURRAI.
J’ai demandé à rester seul avec vous, pour trouver les moyens de rétracter ce que vous avez dit.
LEBRUN.
Ce que j’ai dit ?...
MURRAI.
Vous avez hautement accusé votre femme d’adultère.
LEBRUN.
Oh ! oui, oui, je me rappelle, et lui, il était là présent, et ils m’ont arrêté ; mais, je vous le jure par mon honneur outragé, cet homme mourra de ma main !
MURRAI.
Songez, d’abord, que vous venez de déverser l’infamie sur votre maison ; songez qu’il y a désormais une tache d’opprobre sur le nom de votre fille.
LEBRUN.
Ma fille !... ma fille !... Oh ! malheureux ! je l’avais oubliée !...
MURRAI.
Du courage ! point de larmes inutiles, et lâchons de réparer le mal que vous avez fait... Vous avez révélé un secret terrible à la face de tout le monde... cette révélation brise désormais tous vos liens de famille, et appelle l’infamie sur le seuil de votre maison...
LEBRUN.
C’est vrai, mon honneur est perdu... il ne me reste plus qu’à le venger !...
MURRAI.
Mais cette vengeance effacera-t-elle la honte de votre enfant ?...
LEBRUN.
Mais, que faire, docteur, que faire pour la sauver ?
MURRAI.
Dans mon saisissement, ma surprise, j’ai dit que c’était un accès de folie.
LEBRUN.
Fou !... oui, je l’étais en effet, moi, qui, après un mois de contrainte, n’ai pas su me taire une heure de plus pour sauver mon honneur... Mais, encore une fois, docteur, n’est-il aucun moyen ?...
MURRAI.
Il n’en est qu’on seul.
LEBRUN.
Oh ? parlez... parlez !
MURRAI.
Il faudrait par vos paroles et vos actions ne pas démentir ce que j’ai dit.
LEBRUN.
Comment ?
MURRAI.
Puis, en passant quelque temps dans ma maison de santé...
LEBRUN.
M’enfermer !... renoncer à ma liberté !... passer pour fou !... oh ! jamais !... jamais !
MURRAI.
Soit ! vivez donc avec une épouse flétrie par vous, avec les caresses d’un enfant dont vous avez souillé l’avenir.
LEBRUN.
Oh ! docteur, par pitié...
MURRAI.
Et plus tard, n’aurez-vous pas à vous reprocher son malheur ? et quel gendre trouverez-vous qui voudra apporter son nom pur et sans tache dans une maison souillée et déshonorée ?... quel homme voudra confier son honneur à la fille de l’adultère ?...
LEBRUN.
Oh ! grâce, grâce, mon ami !...
MURRAI.
Songez-y... dans quelque temps je puis annoncer votre guérison, et vous viendrez jouir de la tendresse de votre enfant que vous aurez sauvée.
LEBRUN.
Eh bien ! oui, pour elle !... pour elle !... mais il faudra donc m’en séparer ? quitter ma fille ?
MURRAI.
Il faudra même devant eux ne pas la reconnaître, pour qu’ils croient à votre folie.
LEBRUN.
Oh ! que vous faut-il donc ?
MURRAI.
Un homme qui soit fou pour le reste du monde, jusqu’au moment où je le rendrai à la liberté, à l’honneur... Votre réponse ?
LEBRUN.
J’obéirai.
MURRAI.
Les voilà... songez à l’avenir de votre fille.
Scène XIII
TOUT LE MONDE, excepté Maurice, revient en scène, LEBRUN est assis sur le devant du théâtre
MURRAI.
Ce que je disais est vrai !...
À mi-voix.
sa raison est égarée.
GADICHET.
Comment, non pauvre patron !... si c’était moi, vu mon coup de marteau, ça se comprendrait.
MURRAI.
Qu’on amène une voiture !...
À Jenny.
Madame, présentez-lui sa fille !
JENNY.
Mais, monsieur...
MURRAI, bas.
Faites ce que je vous dis.
Jenny s’approche de Lebrun et lui présente sa fille ; le docteur s’approche aussi de lui et lui prend la main.
MURRAI, bas.
Songez à son avenir !
LEBRUN, d’un air égaré.
Que me voulez-vous ?... Laissez-moi, laissez moi !... éloignez cet enfant !
Il pleure.
GADICHET.
Que dit-il ?
SOPHIE.
Comment, tu ne veux pas m’embrasser, tu me repousses !
LEBRUN, bas.
Oh ! partons... partons, docteur !
JENNY.
Mais, monsieur, votre fille...
LEBRUN, d’un air égaré.
Ma fille !... laissez donc, vous dis-je... je... je ne la connais pas !
TOUS.
Oh !
SOPHIE.
Tu ne me reconnais pas, dis-tu ; mais c’est moi, ta Sophie, ta fille... oh ! mais, embrasse-moi donc.
LEBRUN, bas.
Mon cœur se brise, se déchire...
Haut.
Éloignez-la, éloignez-la !
SOPHIE.
Mais non, non, c’est impossible !... Oh ! il ne me répond pas... mon dieu, mon dieu, que t’ai-je fait !
Elle tombe à genoux ; Lebrun va pour l’embrasser, Murrai l’arrête.
UN DOMESTIQUE.
La voiture.
MURRAI.
Allons, mon ami !...
LEBRUN, bas à Jenny.
Madame, je vous laisse ma fille !... Dieu vous voit et vous juge !
ACTE II
Dans la maison de fous du docteur Murrai, un jardin entouré de murailles élevées. Une cloche est sus pendue à un poteau.
Scène première
PLUSIEURS DOMESTIQUES sont occupés à ranger des bancs et à ratisser le jardin
PREMIER DOMESTIQUE.
Je vous demande si c’est la peine de bien ranger, de tout nettoyer dans ce jardin, lorsque dans une heure on va y lâcher une cinquantaine de fous qui vont tout bouleverser.
DEUXIÈME DOMESTIQUE.
Le fait est qu’il y en a qui ont de bien singulières folies : l’un vient tous les jours à midi régler le soleil sur sa montre ; l’autre écoute ce que disent les tulipes, et parle aux oreilles d’ours.
PREMIER DOMESTIQUE.
Le plus drôle, c’est le petit forgeron, celui qui a eu la tête fêlée d’un coup de marteau... Gadichet !...
DEUXIÈME DOMESTIQUE.
Qui cherche son chemin partout ,jusque dans ses poches...
Scène II
LES DOMESTIQUES, MURRAI
MURRAI.
Tout est-il en ordre ?
DEUXIÈME DOMESTIQUE.
Oui, monsieur.
MURRAI.
Vous ne laisserez sortir ce matin que M. Lebrun et le petit Gadichet... si toutefois sa folie n’est pas trop bruyante.
PREMIER DOMESTIQUE.
Lui administrera-t-on des douches aujourd’hui ?
MURRAI.
Il faut que je le voie d’abord, vous me l’amènerez dans mon cabinet !... c’est une singulière folie que la sienne, elle demande des soins particuliers... À propos, êtes-vous allé chez M. Édouard d’Harcourt ?
DEUXIÈME DOMESTIQUE.
Oui, monsieur.
MURRAI.
Et a-t-on de ses nouvelles ?
DEUXIÈME DOMESTIQUE.
Aucunes, monsieur.
MURRAI, à part.
Cela est étrange... il m’avait promis de partir de quitter la France ; je l’avais adressé à un ami de Bruxelles, et je reçois une lettre qui m’apprend qu’il n’y a pas paru. Depuis un mois, je le fais chercher vainement. Où l’a donc encore en traîne cette ardente mobilité qui me désespère ? Si madame Lebrun avait disparu, je penserais qu’il l’a suivie ; mais elle n’a pas quitté la de meure de son mari... Insensé ! sa passion l’aurait elle entraîné à quelque acte de désespoir ? oh ! mon inquiétude est mortelle.
PREMIER DOMESTIQUE.
S’il vient quelque visite, monsieur sera-t-il visible ?
MURRAI.
Oui, vous me préviendrez.
Il sort.
Scène III
LES DOMESTIQUES, puis LEBRUN
DEUXIÈME DOMESTIQUE.
Je n’ai jamais su quel était le genre de folie de M. Lebrun.
PREMIER DOMESTIQUE.
Elle n’est pas violente, et son traitement est bien doux... Il faut surtout qu’il soit toujours seul : excepté M. le docteur, personne ne doit lui adresser la parole.
DEUXIÈME DOMESTIQUE.
Le voici, retirons-nous.
Ils sortent par la gauche ; Lebrun entre par la droite, et vient s’asseoir sur le devant du théâtre.
LEBRUN.
Trois mois, trois mois qu’au nom de l’honneur et de ma fille, ils me tiennent renfermé dans cette horrible maison... Trois mois que je traîne mes douleurs parmi cette foule d’infortunés ! Infortunés ! eh ! mon dieu, qui faut-il plaindre ici, eux ou moi ? Qu’est-ce donc que leur folie ? tous les désirs comblés, les ambitions satisfaites !... La souffrance ne se tient pas sans cesse attachée à leur âme pour la déchirer comme elle me déchire. S’ils pleurent une mère, un enfant, ils les retrouvent dans leur démence, et leur démence est presque un bonheur... Mais moi, qui ne puis embrasser ma fille, et lorsque j’aurai accompli la mission de dévouement que je me suis imposée pour elle, le monde me recevra avec des rires, des sarcasmes : il était fou, dira-t-on, fou de jalousie ridicule... Un mari... fou de jalousie et d’amour, ah ! ah ! ah !... oh ! ma fille, ma fille !...
Scène IV
LEBRUN, MURRAI
MURRAI.
Lebrun !
LEBRUN.
Ah ! vous voilà, docteur... eh bien ! n’est-ce pas aujourd’hui que je sors enfin de cette maison ?
MURRAI.
Peut-être demain seulement.
LEBRUN.
Comment ?
MURRAI.
Je devais aujourd’hui annoncer votre guérison, et...
LEBRUN.
Demain, dites-vous : encore tout un jour sans embrasser mon enfant...
MURRAI.
Votre courage vous abandonnerait-il ?
LEBRUN.
Lorsque vous m’avez dit qu’il fallait aux yeux du monde une sanction légale de ma folie... eh bien ! j’ai consenti. Un homme est venu, revêtu de je ne sais quelle autorité ; devant lui, j’ai répété cette horrible scène de démence dont ma maison fut le premier théâtre ; et tandis que mon cœur était déchiré, mon âme brisée par mes souvenirs de désespoir et de honte, j’ai ri devant lui de mon opprobre, et lui aussi cet homme, il a ri de ma folie ; il a dit quelques mots de pitié, et il est parti ; mais cette lutte cruelle se prolonge trop, songez-y, docteur.
MURRAI.
Si vous l’exigez, aujourd’hui, ce soir, je vous ouvrirai la porte de cette maison.
LEBRUN.
Aujourd’hui, oh ! merci, merci, mon ami ! après tant de souffrances, de contrainte, j’aspire à jouir de ma liberté, à reprendre ma raison dont j’ai abjuré les droits ; et ma fille, quel bonheur de couvrir son front de baisers et de caresses !
On entend le bruit d’une sonnette.
MURRAI.
Quelque visiteur sans doute ; rentrez chez vous, et tenez-vous prêt à partir à cinq heures.
LEBRUN.
Soit, à cinq heures ; adieu, Murrai, mon meilleur, mon seul ami.
Scène V
MURRAI, puis ÉDOUARD
MURRAI.
Le malheureux ! l’espoir de sortir de cette mai son, de rentrer dans le monde, lui fait oublier son offense ; mais, plus tard, il se la rappellerait sans doute ; il faut qu’Édouard parte, qu’il s’éloigne pour toujours...
PREMIER DOMESTIQUE.
M. Édouard d’Harcourt.
MURRAI.
Lui !... qu’il vienne, qu’il vienne et laissez nous ; veillez à ce que personne ne puisse nous interrompre...
Édouard entre, le domestique sort.
Édouard, enfin, c’est vous.
ÉDOUARD.
Monsieur !...
MURRAI.
Depuis deux mois, quelle a été votre destinée ?... Serez-vous toujours esclave de cette humeur inquiète, vagabonde qui se nourrit d’illusions et vous fait tout fouler aux pieds pour les saisir ?
ÉDOUARD.
Tout cela est vrai peut-être ; mais qu’importe, puisque je n’ai personne pour partager mon bon heur ou m’aider à supporter mes maux, qu’importe quelle est ma vie !
MURRAI.
Personne !... Édouard.
ÉDOUARD.
Oui, vous vous, docteur, vous avez eu pitié de moi...
MURRAI.
De la pitié !...
ÉDOUARD.
Du reste, ce ne sont pas de sages et prudents conseils que je viens chercher ; maintenant il est trop tard...
MURRAI.
Trop tard, que voulez-vous dire ? parlez, expliquez-vous.
ÉDOUARD.
Une nouvelle est arrivée jusqu’à moi : on dit dans le monde que M. Lebrun a recouvré la raison...
MURRAI.
Recouvré... mais il ne l’a jamais perdue !...
ÉDOUARD.
Comment ?
MURRAI.
Sans doute, c’est moi qui vous ai sauvé, c’est moi qui lui ai fait rejeter sur sa démence ses paroles de colère et de vengeance ; moi, qui lui ai fait racheter son honneur au prix de sa liberté !...
ÉDOUARD.
Mon ami...
MURRAI.
Mais à présent, j’exige que vous partiez, que vous vous sépariez de cette femme...
ÉDOUARD.
M’en séparer !... c’est impossible.
MURRAI.
Impossible !... pourquoi ?
ÉDOUARD.
Silence, nous ne sommes pas seuls.
Scène VI
MURRAI, ÉDOUARD, GADICHET.
Gadichet est grotesquement affublé, il porte des bottes à l’écuyère et tient un fouet à la main.
MURRAI.
Que viens-tu faire ici ?
GADICHET.
Hein !... quoi ?... mon chemin, je cherche mon chemin... eh !... mon chemin...
Il va dans tous les coins du théâtre et cherche jusque sous les chaises.
ÉDOUARD.
Mais je ne me trompe pas, c’est...
MURRAI.
L’apprenti de Lebrun ; la nouvelle de la folie de son maître a fait éclater la sienne, que du reste j’avais toujours prédite.
ÉDOUARD.
Pauvre Gadichet !
GADICHET.
Hein !... qu’est-ce qu’a dit Gadichet ? je veux le voir, Gadichet, où est-il Gadichet ? ça doit être un bon enfant, Gadichet ; il me dira mon chemin.
MURRAI.
Allons, allons, laisse-nous.
GADICHET.
Ah ! c’est toi, veux-tu me rendre mon chemin ?
À Édouard.
Tiens, je ne te connais pas, toi, mais c’est égal ; t’as une bonne tête, tu me feras rendre mon chemin !...
ÉDOUARD.
Quelle singulière folie !
GADICHET, montrant Murrai.
C’est lui, vois-tu, qui me l’a pris mon chemin ; c’est mon ennemi immortel ;
Bas.
il est jaloux de moi, parce que je suis le neveu du soleil et le cousin germain de la pleine lune !... il s’est dit : avec des parents aussi élevés que ceux-là ce gail lard-là va me dépasser dans le monde, alors pour m’en empêcher...
ÉDOUARD.
Eh bien ?
GADICHET.
Pour m’en empêcher, il m’a pris mon chemin.
ÉDOUARD.
Pauvre diable ! en vérité, il me fait de la peine.
GADICHET.
Vois-tu, j’étais bien tranquille, je voyageais sur la route de Bruxelles, tu sais, Bruxelles en Picardie : c’est là qu’il m’a pris mon chemin.
MURRAI.
Allons, allons...
GADICHET.
Où l’as-tu mis mon chemin, hein ! dans ton armoire, dans ton secrétaire ? Ah ! dans ta poche.
Il veut le fouiller.
Mon chemin, rends-moi mon chemin.
MURRAI.
Encore une fois, va-t’en, ou je vais appeler.
GADICHET.
Eh bien ! oui, je m’en vas ; je vais chercher mon chemin, et si je le trouve, je monte à cheval dessus et je me saure au grand galop.
Il sort en criant.
Mon chemin, mon chemin... eh ! mon chemin...
Scène VII
ÉDOUARD, MURRAI
MURRAI.
La folie de l’ouvrier n’a pas peu contribué à faire ajouter foi dans le monde à celle du maître : on s’entretenait de la singularité de l’une, et l’on oubliait celle qui n’était que supposée.
ÉDOUARD.
Mais enfin, vous vous êtes décidé à le déclarer guéri.
MURRAI.
Je ne l’ai pas encore fait officiellement, et pourtant aujourd’hui...
ÉDOUARD.
Aujourd’hui ?...
MURRAI.
Il doit sortir de cette maison.
ÉDOUARD.
Aujourd’hui, il retournera près d’elle, près de sa femme... Oh ! docteur, s’il est vrai que vous vous intéressiez à moi, à lui-même, pour mon salut et le sien, faites que cela ne soit pas.
MURRAI.
Je ne puis le retenir davantage. Renoncez à un amour insensé, partez, quittez la France ; c’est le seul moyen de désarmer sa colère et de détruire les soupçons du monde.
ÉDOUARD.
C’était mon dessein, je vous le jure ; mais 46 maintenant, cela est impossible : s’il rentre aujourd’hui dans sa maison, s’il la revoit, il la tuera.
MURRAI.
Que dites-vous ?
ÉDOUARD.
Il la tuera, vous dis-je.
MURRAI.
Malheureux ! je crains de vous comprendre.
ÉDOUARD.
Eh bien ! oui, mon malheur est au comble : une fatalité acharnée punit bien cruellement cette funeste passion.
MURRAI.
Comment ?
ÉDOUARD.
Eh ! ne croyez pas que je veuille maintenant la séparer de sa famille et de son mari pour qu’elle m’appartienne et que je sois heureux de son amour : l’avenir qui m’est réservé est horrible, car cette femme n’a pour moi que de la haine et du mépris.
MURRAI.
Il se pourrait ?
ÉDOUARD.
Elle part pour se dérober aux regards du monde, pour cacher sa honte et mon crime ; pour fuir la vengeance de son mari... et moi, qui ai détruit son bonheur, je dois la suivre ; car désormais ma vie lui sera consacrée ; je dois être là pour la défendre et détourner, s’il se peut, chaque nouveau malheur ! mais il faut que je me dérobe à ses regards. Ce sacrifice que je lui fais de chaque instant de ma vie, il faut qu’elle l’ignore, parce qu’elle le repousserait avec dédain, avec horreur peut-être ; parce que ma présence même est un supplice pour elle.
MURRAI.
Oui, je comprends tout maintenant ; mais que voulez-vous que je fasse ?
ÉDOUARD.
Retarder de quelques jours le moment de la liberté de son mari : dix jours, je ne vous demande que dix jours pour mettre la mer entre elle et lui.
MURRAI.
Mais il dira que je suis votre complice, et d’ail leurs, savez-vous que ce que vous me demandez m’impose une responsabilité dangereuse ?
ÉDOUARD.
Mais savez-vous que cette résolution peut seule nous sauver tous trois ; que si vous le laissez par tir, il tuera cette femme qui n’est pas coupable, elle ! Oh ! je ne vous supplierais pas maintenant si je pensais qu’il consentît à l’épargner, à accepter mes jours en échange des siens.
MURRAI.
Oh ! le malheureux ! oui, tout cela est terrible.
ÉDOUARD.
Écoutez, docteur, vous m’aimez ; vous me l’avez dit souvent... eh bien ! s’il doit aujourd’hui sortir, lui ou moi, vous nous trouverez morts sur le seuil de votre maison.
MURRAI.
Morts !... dieu !...
ÉDOUARD.
Et maintenant, dites me refusez-vous encore ?
MURRAI.
Eh bien, non ! et s’il le faut, je me perdrai avec vous ou je vous sauverai... Qu’elle parte, partez aussi ! je vous promets dix jours.
ÉDOUARD.
Dix jours... oh ! merci, merci, docteur, mon ami, mon sauveur !... Adieu.
Il sort.
Scène VIII
MURRAI, seul
Oui, ce moyen seul me restait ; et puis, après tout, quand j’aurais refusé de le servir, quand je laisserais Lebrun partir aujourd’hui, les atteindre tous deux pour qu’il se venge, ne serais-je pas responsable du sang versé, n’aurais-je pas un crime à me reprocher !
Scène IX
MURRAI, LEBRUN
MURRAI.
Ah ! vous voilà, mon ami.
LEBRUN.
Oui, docteur, tous mes préparatifs sont faits ; et lorsqu’il vous plaira de donner l’ordre de mon départ...
MURRAI.
Vous désirez donc toujours que ce soit aujourd’hui ?
LEBRUN.
Oh ! oui, cette prison m’étouffe... et puis il me tarde tant de revoir ma fille ! il me semble que maintenant ses caresses auront pour moi plus de charmes ; je les aurai payées de tant de douleurs !
MURRAI.
Et votre femme ?
LEBRUN.
Ma femme !
MURRAI.
Vous allez la retrouver aussi ; quel sera votre accueil pour elle ?
LEBRUN.
Le croiriez-vous, docteur, l’amour que j’éprouve pour l’enfant me ferait oublier la faute de la mère !
MURRAI.
Le malheureux !
LEBRUN.
Oh ! c’est que je l’ai tant aimée cette femme ! et puis, je me rappelle les raisons que vous me don niez en faveur de son innocence ; car vous, docteur, vous n’avez jamais cru à mon déshonneur.
MURRAI.
Oui, cela est vrai ; je n’y croyais pas alors.
LEBRUN.
Alors, dites-vous... mais maintenant ?
MURRAI.
Mon ami, avant que vous ne sortiez, j’ai une. cruelle nouvelle à vous apprendre...
LEBRUN.
Une nouvelle !
MURRAI.
C’est un nouveau coup, le plus cruel de tous peut-être, qui vient vous frapper.
LEBRUN.
Quel est-il ?
MURRAI.
Votre courage, je l’espère, ne vous abandonnera pas ; vous resterez encore quelques jours ici, et mes consolations...
LEBRUN.
Oh ! mais parlez, parlez donc ! ma fille est-elle morte ?
MURRAI.
Non, votre fille existe ; mais votre femme...
LEBRUN.
Ma femme !
MURRAI.
Votre femme s’est enfuie.
LEBRUN.
Oh ! avec lui, n’est-ce pas, Édouard d’Harcourt !... les infâmes !
MURRAI.
Mon ami !...
LEBRUN.
Ainsi, tandis que je n’exilais de la société, que je renonçais à la liberté, à l’estime de tous ; que je m’enfermais vivant dans cet enfer, c’est elle qui renverse tout ce que j’ai fait pour elle, c’est elle qui arrache le voile que j’ai mis à son infamie !
MURRAI.
Mon ami !...
LEBRUN.
Eh bien, tant mieux ! la vengeance est méritée. Oh ! maintenant ma vengeance est sainte, maintenant je puis l’avouer, maintenant je puis l’assouvir.
MURRAI.
Qu’allez-vous faire ?
LEBRUN.
Les suivre.
MURRAI.
Mais vous ignorez leur asile.
LEBRUN.
Je le saurai bientôt, la vengeance est un bon guide ; je les découvrirai, et alors...
MURRAI.
Alors vous vous battrez avec Édouard.
LEBRUN.
Me battre ! oh ! non, non, les armes sont souvent perfides ; le sort peut me trahir, et je veux me venger.
MURRAI.
Vous voulez donc l’assassiner !... oh ! non, non, cela ne sera pas... Écoutez-moi, de grâce !
LEBRUN.
Plus un mot, je veux partir ; et que me diriez vous pour me retenir ? Je n’ai plus rien à ménager maintenant, ni mon honneur, ni le sien, à elle, ni celui de ma fille ; car mon honneur, le sien et celui de mon enfant, le misérable a tout flétri... Vous voyez bien qu’il faut que je parte, vous voyez bien qu’il faut que je me venge...
MURRAI.
Non, non, je ne vous laisserai pas sortir que vous ne m’ayez promis de respecter la vie de ce jeune homme.
LEBRUN.
Eh quoi, c’est pour lui que vous priez ?...
MURRAI.
Pour lui je ferais plus encore ; et si la prière ne suffisait pas...
LEBRUN.
Est-ce un rêve ? Mais rappelez-vous donc son crime et ma honte...
MURRAI.
N’importe,, vous ne tuerez pas Édouard.
LEBRUN.
Ah ! parce que la justice des hommes est impuissante pour de tels crimes, parce qu’il n’y a pas eu de sang versé, il faudra que je me taise ! Oh ! non ; quand l’honneur d’un homme, d’une famille est ainsi flétri, l’outragé repousse la loi et s’arme du fer... Adieu... docteur...
MURRAI.
Arrêtez !... vous ne tuerez pas Édouard, vous dis-je !
LEBRUN.
Mais, pourquoi, pourquoi ?...
MURRAI.
Eh bien !... parce qu’il est mon fils !...
LEBRUN.
Votre fils ?...
MURRAI.
Oui, mon fils ; celui d’une femme dont on me sépara, de ma seule passion. C’est mon enfant, vous dis-je ; et comme vous voulez venger le vôtre, moi, je veux sauver le mien...
LEBRUN.
Ah ! je vous comprends maintenant. Oui, c’est pour cela que je m’abusais, quand je le soupçonnais : c’était votre fils !... c’est pour cela qu’alors j’étais un insensé, un fou, sans doute : c’était votre fils !... c’est pour cela que vous m’avez conduit ici et protégé son crime ; c’est pour cela que vous m’y retenez de force, pour protéger aussi leur fuite, n’est-ce pas ?... Cela est juste, naturel : ah ! ah ! ah ! c’était votre fils !...
MURRAI.
Assez, monsieur.
LEBRUN.
Maintenant, il faut que la porte de cette maison s’ouvre devant moi !...
MURRAI.
Vous n’en sortirez pas.
LEBRUN.
Et qui pourrait m’y retenir ?...
MURRAI.
Tout ! mes ordres, votre folie, qui est constatée et légale, qui me donne le droit de vous retenir de vive force.
LEBRUN.
Malheureux ! songez à ce que vous faites ! Ma vengeance sera double !
MURRAI.
Je sais que c’est une lutte à mort entre nous ; il y va de mon honneur et de ma vie ; mais il me faut avant tout l’honneur et la vie de mon fils, et cette porte ne s’ouvrira pour vous, que sur votre serment de respecter ses jours...
LEBRUN.
Jamais !
MURRAI.
Vous resterez donc !
Il agite la cloche.
LEBRUN.
Misérable !... tu me laisseras sortir... ou sinon...
Il va s’élancer sur lui ; les gardiens entrent et le saisissent ; Gadichet entre aussi, et va se placer au milieu d’eux, en poussant un grand éclat de rire.
Scène X
MURRAI, LEBRUN, GADICHET, GARDIENS
GADICHET.
Ah ! ah ! ah ! j’ai retrouvé mon chemin.
MURRAI.
Messieurs, la maladie de M. Lebrun vient de prendre un caractère plus alarmant que jamais... Il ne sortira pas aujourd’hui.
LEBRUN.
Oh ! ne le croyez pas ! ne le croyez pas ! il ment.
MURRAI.
Sa nouvelle folie se décèle par une rage violente contre moi.
LEBRUN.
Fou ! fou, dis-tu ? mais ce n’est pas. Vous, qui êtes là, je vous reconnais tous ; et toi aussi, Murrai. C’est bien toi qui sacrifies un honnête homme aux passions d’un misérable, de ton fils, comme autrefois, sans doute, tu as sacrifié ce fils, ignoré de tous, à ton orgueil et à ton ambition : tu vois bien, docteur, que je te reconnais ? Je te dis que tu es un infâme ; tu vois bien que je ne suis pas fou ?...
MURRAI.
Vous m’insultez, monsieur !...
LEBRUN.
Je t’insulte !... Prends garde, tu oublies ton rôle : je t’insulte, dis-tu ? Médecin des fous, de mandes-tu raison d’une insulte à tes malades ?
MURRAI.
Je m’oubliais... il faudra maintenant le surveiller de plus près...
À part.
Mon fils !... mon fils !...
Il sort suivi des gardiens.
Scène XI
LEBRUN, GADICHET
LEBRUN.
Que faire ? que devenir ? je lui appartiens, corps et âme ; car il l’a dit, ma folie est avérée maintenant, et il peut m’enchaîner ici tant qu’il lui plaira !... et, pendant ce temps, son fils, cet infâme, se rira de ma faiblesse ; il n’y aura pas de vengeance pour moi, et, pour eux, ni troubles, ni remords... Oh ! mais c’est à en devenir réellement fou ; et personne qui s’intéresse à moi, et me sauve... personne !... personne ! GADICHET.
Si fait, y a quelqu’un !
LEBRUN.
Que dis-tu ?...
GADICHET.
Je dis qu’il y a quelqu’un qui vous comprend.
LEBRUN.
Qui donc ?...
GADICHET.
Eh bien ! moi, donc !
LEBRUN.
Toi !... que peux-tu faire ?...
GADICHET.
Beaucoup.
LEBRUN.
Comment !
GADICHET.
Puisque j’ai retrouvé mon chemin...
LEBRUN.
Allons ! j’oubliais sa folie !... Il ne connaît pas son malheur ; je suis plus à plaindre que lui.
GADICHET.
À plaindre !... mais, si vous voulez, vous ne le serez plus ?...
LEBRUN.
Comment ?...
GADICHET.
Sans doute, puisque j’ai retrouvé...
LEBRUN.
Encore ! laisse-moi, laisse-moi.
GADICHET.
Là, vous aussi, vous allez me repousser me dire que je suis fou, et, pourtant, c’est pour vous que je suis ici.
LEBRUN.
Pour moi ?...
GADICHET.
Sans doute ; quand on a déclaré que vous étiez fou, moi, seul, je n’ai pas voulu le croire...
LEBRUN.
Toi !
GADICHET.
Car je soupçonnais le docteur et le cafard... Alors, quand j’ai su qu’on vous amenait ici, je me suis dit : Eh bien ! il n’ira pas seul ; moi, aussi, je veux être fou, et cela me sera facile, puisqu’ils ont toujours dit que j’avais une fêlure, et que je le deviendrais.
LEBRUN.
Mais il semble que la raison lui revient.
GADICHET.
Alors, avec un peu d’adresse, je me suis fait enfermer ici... j’écoutais, j’épiais le docteur... et plusieurs fois, lorsque je me trouvais au milieu de ces malheureux, privés de raison... lorsqu’on me torturait de traitements, j’ai senti mon sang bouillir, mes idées s’obscurcir, ma tête, ma pauvre tête s’échauffer, jusqu’à me faire craindre une vraie folie ; mais, alors, je faisais un effort sur moi-même, je me raidissais contre le mal, en me disant : Du courage, Gadichet ! courage, mon ami ! il faut sauver ton maître, ton bon maître, que tu aimes tant ; et je sortais victorieux !...
LEBRUN.
Oh ! mon ami, achève ! achève !...
GADICHET.
Ici, tout le monde se moquait de moi ; on riait de ma singulière folie, lorsque j’allais furetant partout, en disant : mon chemin ! mon chemin ! Le docteur, lui-même, me laissait l’aborder sans défiance ; eh bien ! pendant ce temps, j’avais sur pris son secret, celui de votre rival !...
LEBRUN.
Il se pourrait !...
GADICHET.
Je savais qu’il faudrait vous arracher de force de leurs griffes, et, mon chemin, je le cherchais réellement...
LEBRUN.
Ah ! mon ami !...
GADICHET.
Enfin, Dieu a béni mes efforts ; ce matin, j’ai découvert un passage secret qui donne dans la campagne ; il n’y avait plus de temps à perdre ; je suis allé prévenir deux de vos ouvriers, deux bons ; je leur ai dit ce qui se passait, et ils vont venir...
LEBRUN.
Ils vont venir, dis-tu ?...
GADICHET.
À trois heures...un signal convenu... Eh ! tenez, voici l’heure !...
On entend sonner l’heure, et frapper dans la main.
LEBRUN.
Oui, et le signal, le signal aussi... Oh ! comme mon cœur bat !...
GADICHET.
Entendez-vous ? les voilà ; ce sont eux !
Scène XII
LEBRUN, GADICHET, DEUX OUVRIERS
BUDAN.
Venez, venez, monsieur !
LEBRUN.
La liberté et la vengeance ! Oh ! merci, merci, mes amis !...
GADICHET.
Allons ! ne perdons pas de temps...
LEBRUN.
Oui, partons ! Eux, d’abord ; loi, ensuite, docteur Murrai !
GADICHET.
Oui, au revoir, savant docteur ; et ; maintenant, je reprends ma raison, au diable la maison des fous !...Ah ! ah ! ah ! j’ai retrouvé mon chemin !
Il fait sauter les chaises, et ils sortent.
ACTE III
Le théâtre représente un salon ; au fond, une grande porte : à droite et à gauche, deux portes latérales ; à gauche, et sur le second plan, une fenêtre.
Scène première
JENNY, seule
Elle est pâle, vêtue seulement d’un peignoir blanc ; elle occupée à écrire devant une table.
Grâce à cette lettre, grâce à la déclaration que je fais ici, ils mettront bientôt fin à cette captivité ; et s’il apprend que c’est moi qui l’arrache au supplice qu’il endure, il cessera peut-être de me maudire. Cet espoir soutient mon courage... Quelle manœuvre infâme ils ont employée pour le retenir, lui si bon, si généreux ! que ses souffrances doivent être cruelles ! oh ! chaque instant de retard est peut-être une nouvelle torture pour lui. Il serait bien vengé s’il savait ce que je souffre ici... s’il me voyait si pâle, presque mourante !
Elle sonne.
Scène II
JENNY, UNE SERVANTE
LA SERVANTE.
Madame a sonné ?
JENNY.
Oui, dites-moi d’abord combien faut-il de temps pour qu’une lettre parvienne à Paris ?
LA SERVANTE.
Trois jours, madame.
JENNY, à part.
Trois jours ; lorsqu’elle arrivera j’aurai peut-être cessé de souffrir.
Haut.
M. Peterson ne s’est pas présenté ?
LA SERVANTE.
Je vous demande pardon, il est là, attendant que madame soit visible.
JENNY.
Faites-le entrer à l’instant.
LA SERVANTE.
Oui, madame.
Elle sort.
Scène III
JENNY, puis PETERSON
JENNY.
Mon Dieu ! laissez-moi assez de force pour accomplir jusqu’au bout la tâche que je me suis imposée.
Peterson entre.
PETERSON.
Madame, vous m’avez fait appeler, et je me mets à vos ordres.
JENNY.
C’était une prière que je vous adressais, monsieur !
PETERSON.
Une prière ?
JENNY.
Oui, je réclame de vous un nouveau service, le plus important de tous.
PETERSON.
Parlez, madame, j’ai des droits à votre confiance.
JENNY, d’une voix faible.
D’abord, monsieur, soyez assez bon pour vous asseoir et vous approcher ; je suis si faible, que je crains que mes paroles n’arrivent pas même jus qu’à vous.
Peterson s’assied.
PETERSON.
Je vous écoute.
JENNY.
Dès mon arrivée dans cette ville, vous m’avez entourée de votre bienveillance, de votre généreuse protection, et cela avec un dévouement qui ne s’est jamais démenti.
PETERSON.
Qui n’eût pas été ému de vos souffrances et des malheurs qu’on lisait sur votre front !
JENNY.
Tant de bonté m’enhardit et me donne le cou rage de m’adresser à vous dans une circonstance grave, d’implorer votre appui comme homme et comme magistrat !...
PETERSON.
Parlez, madame, que dois-je faire ?
JENNY.
Je suis la cause d’une grande injustice qui a été commise en France, et je veux y mettre fin.
PETERSON.
Une injustice ?
JENNY.
Par suite d’un acte sublime de dévouement et de résignation, un infortuné s’est mis à la discrétion d’un homme qui abuse cruellement de son pouvoir, et le fait servir à d’infâmes projets. Il s’agit, monsieur, d’arracher la victime des mains de cet homme ; vous me seconderez, n’est-ce pas ?...
PETERSON.
Mais, comment puis-je vous être utile, et sauver ce malheureux ?... JENNY.
Le coupable est un médecin de Paris. Je viens de lui écrire pour le menacer d’une entière révélation ; mais, craignant que le temps ne me manque pour suivre l’effet de cette lettre, j’ai tracé à la hâte une relation de cette déplorable histoire... et, après ma mort...
PETERSON.
Oh ! madame, ne parlez pas ainsi ; vous, si jeune, si pleine d’avenir !
JENNY.
Ne cherchez pas à me donner un espoir que je ne désire plus ; la vie me serait une souffrance trop cruelle... Après ma mort... cette relation vous sera remise... Comme homme, vous vous adresserez d’abord à ce médecin, et lui parlerez la voix de l’honneur ; si ce langage sacré n’est pas entendu, s’il refuse, comme magistrat vous poursuivrez cette réparation... Pardonnez-moi si je me tais aujourd’hui sur le secret de mes malheurs ; vous lirez ce récit quand ma voix se sera tue pour toujours, quand mon front ne pourra plus rougir !...
PETERSON.
Vos désirs seront fidèlement remplis ; et si la certitude que l’injustice sera réparée peut apporter quelque soulagement à vos maux, je vous la donne, madame, je vous la donne tout entière !
JENNY.
Merci, merci, monsieur.
PETERSON.
Du courage ! madame, du courage ! et comptez toujours sur mon dévouement.
Il sort.
Scène IV
JENNY, seule
Mon dieu ! être sans espoir à mon âge ; éloignée de ma fille, de tout ce qui m’est cher ; en horreur, peut-être, à un mari que j’aime ; forcée de me soustraire à sa colère et au mépris du monde ; n’avoir plus d’autre refuge que la mort, et pouvoir dire, je ne suis pas coupable ! oh ! cela est horrible... Et lorsque je me rappelle cette longue et heureuse carrière qui semblait m’être promise, cet avenir de bonheur qui me souriait autrefois, ces joies de mère et d’épouse qui s’échappent pour faire place au désespoir et à la mort... Pardonnez moi, mon Dieu ! mais, alors, mon âme déchirée se révolte contre mon malheur ; je me dis : mais, je ne suis pas coupable, et le ciel est injuste... Oh ! pardonnez-moi, mon Dieu ; c’est un supplice si cruel pour le cour d’une pauvre femme !...
Scène V
JENNY, LA SERVANTE, ensuite ÉDOUARD
LA SERVANTE.
Madame, un jeune homme demande à vous parler !
JENNY.
Un jeune homme ! son nom ?...
LA SERVANTE.
Je l’ignore, madame ; mais il dit qu’il faut absolument qu’il vous voie ; qu’il vous apporte des nouvelles de votre mari...
JENNY.
De mon mari ! Quel que soit cet homme ; qu’il vienne !
La servante sort.
qu’il vienne !... Grand dieu ! est-ce un nouveau malheur, ou dois-je espérer ?...
Édouard entre.
Encore vous !... oh ! mon dieu, vous me pour suivrez donc sans relâche ?...
ÉDOUARD.
Écoutez, madame, il s’agit de vous, il faut m’entendre...
JENNY.
Votre voix me glacé... Qu’avez-vous donc à me dire ?...
ÉDOUARD.
Ah ! ne craignez plus de ma bouche un seul mot qui éveille de cruels souvenirs !
JENNY.
Mais, pourquoi vous être obstiné à me suivre ?
ÉDOUARD.
Je voulais être là, près de vous, pour vous défendre et vous protéger...
JENNY.
Me protéger ! me défendre !... et contre qui ?... N’êtes-vous pas mon plus mortel ennemi ?...
ÉDOUARD.
Madame !
JENNY.
Ne deviez-vous pas songer que votre présence était pour moi un éternel supplice ? et si vous aviez des remords, la honte écrite sur votre front ne devait-elle pas sans cesse me rappeler la mienne ; vos larmes ne devaient-elles pas réveiller, et me rendre plus poignant le souvenir de votre crime !... Encore une fois, monsieur, pourquoi m’avez-vous suivie ?
ÉDOUARD.
Assez, assez ! si vous saviez quel horrible tourment j’éprouve, quel mal me fait chacune de vos paroles... oh ! je donnerais ma vie pour un mot de vous qui ne fût pas de la haine et du mépris.
JENNY.
Vous vous plaignez, et moi donc, moi, que dirai-je, monsieur ?... J’étais jeune, et mes traits sont flétris, et vous m’avez ôté les jours que j’avais à vivre. Le monde me regardait avec envie, il prononce mon nom avec mépris ; j’étais heureuse et fière de l’amour de mon mari et de ma fille, vous m’avez arraché ma fille et rendue indigne de mon mari ; j’étais remplie d’espoir et d’avenir, et je meurs...
ÉDOUARD.
Oh !... Jenny !...
JENNY.
Et je n’ai pas même cette mort paisible et heureuse qui s’accomplit entourée d’une famille au milieu des regrets et des larmes de ceux qui nous aiment ; je meurs comme une coupable, loin de tout ce qui m’est cher, et n’ayant que vous à non chevet, que vous, dont la présence et les regards : me déchirent de me, comme s’il ne suffisait pas tuer sans jouir encore de mon agonie.
ÉDOUARD.
Oh ! grâce, grâce, madame !
JENNY.
Voilà ce que vous avez fait, monsieur ; et maintenant, dites, dites, est-ce à vous de vous plaindre, et moi, n’ai-je pas le droit aujourd’hui de vous donner un ordre !...
ÉDOUARD.
Un ordre ! oh ! parlez, parlez... quel qu’il soit...
JENNY.
Eh bien ! je vous ordonne de vous éloigner de moi, de partir.
ÉDOUARD.
Madame, j’avais juré de ne jamais me présenter devant vous, et ce serment je ne l’aurais pas violé aujourd’hui sans une circonstance que je viens d’apprendre : c’est elle qui m’a donné la force de pénétrer ici ; c’est elle aussi qui m’empêche de vous obéir...
JENNY.
Que voulez-vous dire ?...
ÉDOUARD.
Que votre mari s’est enfui de la maison du docteur Murrai...
JENNY.
Lui ! oh ! merci, merci, mon Dieu... Mais vous voyez bien qu’il faut que vous partiez ; car il est sur mes traces sans doute, et songez que sa première vengeance vous regarde.
ÉDOUARD.
Qu’importe, moi ! mais s’il vous découvrait ?
JENNY.
Il est mon maître.
ÉDOUARD.
Mais il vous tuerait, je ne partirai pas...
JENNY, avec force.
Vous partirez, vous dis-je ! voulez-vous qu’il expose sa vie contre la vôtre ? vous avez arraché sa mère à mon enfant... voulez-vous maintenant assassiner son père ?...
ÉDOUARD.
J’obéirai !...
JENNY sonne, la servante arrive.
Voici ma volonté : vous vous éloignerez encore de la France, vous laisserez ignorer à tout le monde le lieu que vous habiterez ; et puisse le ciel vous pardonner un jour !
ÉDOUARD, ému.
Madame... et vous ?
JENNY.
Partez à l’instant.
ÉDOUARD, à part.
Non, non, je dois encore veiller sur elle.
Il sort.
JENNY, à la servante.
Aide-moi à rentrer dans ma chambre ; je souffre...
Elle s’appuie sur son bras et sort ; la scène reste vide un instant.
Scène VI
GADICHET, entrant par la porte du fond
Personne !... tant mieux... Voyons, examinons bien les localités : par là, la chambre de madame, au bas de cette fenêtre la basse-cour ; y a un tas de fumier, ça peut me faire un chemin au besoin... Depuis deux heures que nous sommes arrivés, j’ai eu le temps de me mettre au courant, et maintenant le bourgeois peut entrer...
Il l’appelle.
Patron, patron !...
Scène VII
GADICHET, LEBRUN
LEBRUN, entrant.
Enfin, c’est bien ici, n’est-ce pas ?...
GADICHET.
Complètement ! j’ai entendu causer la bourgeoise ; elle est à présent dans sa chambre !...
LEBRUN, qui ne l’écoute pas.
Je suis donc parvenu à les découvrir, à les joindre, et bientôt je pourrai me venger... Murrai !... le misérable !... il a déclaré qu’un fou s’é tait évadé de sa maison.
GADICHET.
Il en a bien déclaré deux de fous.
LEBRUN.
Il m’a fait poursuivre, traquer comme une bête fauve ; mon signalement a été envoyé partout, et ce n’est pas sans peine que j’ai pu leur échapper...
GADICHET.
Et moi donc ! comme il se doutait pas de ma folie, il a dit qu’on me reconnaîtrait aisément, vu que je cherche toujours mon chemin... possible que je le cherche encore, mais je ne le dis plus...
LEBRUN.
Oh ! mais patience, que j’aie retrouvé son fils, que je me sois vengé, et son tour viendra.
GADICHET.
Silence, j’entends quelqu’un.
LEBRUN.
Quelqu’un ?
GADICHET.
Oui, par là, dans la chambre de votre... de la bourgeoise.
LEBRUN.
Elle !... je vais la revoir !
GADICHET.
Croyez-moi, patron, rentrez là, et contenez-vous ; moi, je vais faire le guet au dehors...
Lebrun rentre dans sa chambre et se tient caché derrière la porte ; Gadichet sort.
Scène VIII
JENNY entre, elle marche avec peine, se soutient à chaque meuble et vient s’asseoir sur le devant du théâtre
JENNY.
Impossible de prendre un instant de repos ! la fièvre me brûle, et des songes terribles viennent m’assaillir... Lui, mon mari, je le vois accablé de douleur, de désespoir, enchainé dans cette terrible maison, et maudissant mille fois celle qui cause son supplice... ou bien, il m’apparaît menaçant, et me dit : madame, qu’avez-vous fait de l’honneur de notre fille ?...
LEBRUN, s’approchant et lui mettant la main sur l’épaule.
Madame, qu’avez-vous fait de l’honneur de notre fille ?
JENNY.
Ah !... lui, lui, mon dieu !... oh ! mais il est donc vrai, vous êtes libre ?
LEBRUN.
Oui, libre, et je viens ici avec une mission de vengeance... vous le croyez, n’est-ce pas ?
JENNY.
Oui, je vous crois, monsieur.
LEBRUN.
Savez-vous, madame, ce que j’ai souffert à cause de vous, ce qui s’est amoncelé dans mon âme de haine et de douleurs... Savez-vous ce que m’ont coûté de tortures et de supplices le séjour de cette infâme maison et le jeu cruel de ma folie ?... mais je suis libre enfin, et je viens faire justice !...
JENNY.
Oh ! je sais, monsieur, qu’il vous faut une vengeance terrible, car cette vengeance vous relèvera devant le monde et fera expirer le rire sur toutes les lèvres, car on ne se raille plus de l’homme dont les mains sont rougies d’un sang coupable ; mais, je vous le jure, monsieur, je suis innocente !...
LEBRUN.
Mensonge et infamie !
JENNY.
Oh ! vous ne me croyez pas... il le faut pour tant... Écoutez, monsieur, ce moment est solennel, et je ne crains pas votre vengeance.
LEBRUN.
C’est bien, madame, vous bravez la honte et votre front ne sait plus rougir !
JENNY, à genoux.
Monsieur !... Ah ! monsieur, tuez-moi, mais rappelez-vous au moins mes dernières paroles... Par ma fille, je ne suis pas coupable
LEBRUN, la relevant.
Et pourtant vous êtes ici.
JENNY.
Écoutez-moi, monsieur, oh ! vous pouvez me croire maintenant que je ne tiens plus au monde que par le sentiment de mes douleurs.
LEBRUN.
Que signifie... oui, je n’avais pas remarqué cette pâleur... Oh ! le remords tue vite aussi !...
JENNY.
Le remords ! vous saurez bientôt, monsieur, s’il pouvait m’atteindre... mais fussé-je coupable, vous ne devriez pas refuser une grâce à une mourante !...
LEBRUN.
Je vous écoute, madame.
JENNY.
Qu’un instant au moins je puisse vous regarder sans que votre figure exprime le mépris et la haine ! Oh ! je ne vous ai pas outragé, monsieur, je vous aimais de toutes les forces de mon âme !...
LEBRUN.
Madame !...
JENNY.
Je vous aimais comme je vous aime encore ; car j’ai plus souffert de vos douleurs que des miennes : toutes mes larmes ont été pour vous, pour ma fille, et mon dernier regard, mon dernier soupir vous appelleront encore... Oh ! ne détournez pas les yeux, et laissez-moi votre main. Mon dieu ! je voudrais tout oublier, ne pas songer, pour quelques instants qui me restent à vivre, que votre haine, votre mépris, nous séparent ; je voudrais dire : tout cela n’est qu’un songe affreux qui finit, voilà l’homme que j’aime, et qui n’aime toujours...
LEBRUN.
Ceci est le rêve, madame ; mais le rêve est fini, car vous avez brisé les liens les plus sacrés, car vous êtes ici loin de votre maison et de votre fille, et je n’écoute plus rien...
JENNY, debout, et avec force.
Eh bien !à moi votre vengeance, s’il le faut, mais à un autre l’infamie !
LEBRUN.
Mais à qui donc alors ?...
JENNY.
À cet homme qui, abusant de votre généreuse hospitalité, n’a pas craint en cotre absence de profiter d’une nuit où j’étais accablée sous le poids des veilles passées près de ma fille mourante, à ce lâche qui vous remerciait de vos bienfaits en vous donnant le déshonneur, et à moi le déshonneur et la mort.
Elle tombe accablée sur son siège.
LEBRUN.
Il serait vrai !... Jenny... vous n’êtes pas venu me dire à moi ; il faut venger notre honneur, il faut tuer cet homme !
JENNY.
Je l’aurais dû, mais j’ai eu peur de vous, de lui, qui était là, toujours là.
LEBRUN.
Et c’est maintenant, aujourd’hui seulement que vous vous justifiez !... mais, quelles preuves ?...
JENNY.
Mais en faut-il d’autres que ma vie passée, d’autres preuves que vos bienfaits ! mais rappelez-vous donc votre amour, les soins et la tendresse dont vous m’entouriez sans cesse, les caresses et les baisers de ma fille... Des preuves ! mais était il au monde une femme plus heureuse et plus fière que moi... et j’aurais en vous déshonorant échangé ce bonheur contre le désespoir et la honte !... Oh ! mais si je l’avais désirée cette honte, j’aurais eu assez de force pour la supporter, et elle ne me tuerait pas maintenant !
LEBRUN.
Jenny !... Je vous crois, madame ; ; oui, oui, je vous crois, et je vous vengerai.
Scène IX
JENNY, LEBRUN, GADICHET
GADICHET.
Pardon, excuse, patron ; serviteur, bourgeoise ; mais y a pas de temps à perdre, on vient.
LEBRUN.
Vous ne demeurerez pas ici davantage... venez, madame, venez.
JENNY.
Je suis si faible, que je puis à peine me soutenir.
LEBRUN, à part.
Pauvre femme ! la mort à son âge...
Haut.
Jenny !...
À part.
Édouard d’Harcourt !...
Haut.
Jenny, je vous soutiendrai.
Il lui passe le bras autour de la taille et la soutient.
JENNY.
Vous !... Oh ! monsieur !... monsieur !
Elle le regarde avec des yeux baignés de larmes ; ils sortent par la chambre de Lebrun.
GADICHET.
Pauvre chère femme ! elle m’intéresse... Oh attention, j’entends du monde... à mon poste !
Il se cache derrière le canapé de Jenny.
Scène X
ÉDOUARD, GADICHET caché
ÉDOUARD.
Mon inquiétude est mortelle ! Ces deux hommes dont parle l’hôtesse, qui sont venus prendre de si minutieuses informations... Ils ont loué la chambre voisine, et à la manière dont elle m’a dépeint l’un d’eux, j’ai cru reconnaitre Lebrun.
GADICHET.
La mèche commence à s’éventer.
ÉDOUARD.
Oh ! mon dieu ! que faire ?... que devenir ?... Ange ou démon, personne ne viendra-t-il, personne à mon aide !
Scène XI
ÉDOUARD, GADICHET, MURRAI
ÉDOUARD.
Ah ! c’est vous, docteur !
MURRAI.
Moi-même !
GADICHET.
C’est juste ; il invoquait le démon !
ÉDOUARD.
Venez-vous à mon aide ?
MURRAI.
Peut-être.
ÉDOUARD.
Lebrun est arrivé.
MURRAI.
Je le sais.
ÉDOUARD.
Comment avez-vous appris ?...
MURRAI.
Qu’importe !...
ÉDOUARD.
Il est dans cette maison ; il faut empêcher...
MURRAI.
Un instant, monsieur ; vous ne devez pas paraître devant lui ; il faut me laisser agir... fiez vous à moi ; car maintenant il у de mon honneur et de ma sûreté... J’ai retenu de force, et en charte privée, un homme qui avait toute sa raison ; nos lois sont sévères sur ce chapitre, et, s’il peut le prouver, je suis perdu.
ÉDOUARD.
Mais que ferez-vous ?...
MURRAI.
Mes mesures sont prises. Déjà je suis allé trouver le magistrat de ce quartier, M. Peterson ; je lui ai montré la preuve légale qui atteste la folie de Lebrun...
ÉDOUARD.
Vous avez ce papier ?
MURRAI.
Oui, oui, signé des autorités de France ; le voici.
Il le montre.
Et bientôt Lebrun sera remis entre mes mains...
GADICHET, se montrant.
Entre vos mains, ça ne sera pas !
Il lui arrache le papier.
ÉDOUARD.
Gadichet !
MURRAI.
Malheureux ! rends-moi ce papier, ou sinon...
GADICHET.
Un instant, savant docteur : en avez-vous un aussi qui déclare que vous êtes un honnête homme ; qui atteste et qui prouve, qu’une fois entre vos mains, vous ne l’assassinerez pas ?... montrez-le moi, ce papier, et je vous rends celui-ci.
ÉDOUARD.
Oh ! nous te forcerons bien...
GADICHET, présentant un pistolet.
Arrière ! l’ouvrier aux gants blancs... et vous monsieur le médecin, soyez plus doux avec vos malades...
MURRAI.
Encore une fois, ce papier !
GADICHET.
Mes beaux messieurs, vous voilà deux contre un, ça n’est pas brave ; mais je suis en mesure aussi, moi.
Pendant ce temps, il a roulé le papier, qu’il entre à moitié dans le canon du pistolet ; il le présente à Murrai.
Tu veux r’avoir cet ordre, docteur ; eh bien ! tiens, le voilà dans ce flageolet ; viens le prendre, y te jouera un air.
MURRAI.
Édouard, appelez, et qu’on l’arrête !
GADICHET.
M’arrêter ! j’ai pas peur de ça...
Il s’approche de la fenêtre.
Tu sais bien, docteur, que je sais trouver mon chemin, ah ! ah ! ah !
Il saute et disparaît.
ÉDOUARD, à la fenêtre.
Il s’enfuit... Avant qu’on puisse l’atteindre, il aura détruit cet ordre...
MURRAI.
Je cours chercher le magistrat. Déjà j’ai levé ses scrupules, et la folie de Lebrun est avérée à ses yeux. Vous, prévenez sa femme : je reviens à l’instant.
Scène XII
ÉDOUARD, puis LEBRUN
ÉDOUARD.
Prévenir Jenny, a-t-il dit oui, en effet, j’aurais du...
Il va sers sa chambre, et secoue violemment la porte qui s’ouvre, et Lebrun paraît.
Lui !... c’est lui !...
LEBRUN.
Édouard d’Harcourt !... Ah ! te voilà, enfin !... c’est le ciel qui le livre !...
ÉDOUARD.
Monsieur !...
LEBRUN.
Une fois, déjà, tu es venu frapper à ma porte, et je t’ai accueilli comme un frère !... aujourd’hui, c’est la seconde, et je t’attendais.
ÉDOUARD.
Écoutez-moi, monsieur ; car, en ce moment...
LEBRUN.
Pas un mot... pas un mot !... Tu es à moi, enfin !... Oh ! mais, tu n’auras pas assez de sang pour laver la tache d’infamie dont tu m’as souillé !... pour venger celle que tu as flétrie, et poussée au seuil du tombeau !...
ÉDOUARD.
Je sais que j’ai commis un crime, et qu’il vous faut vengeance : je suis prêt...
LEBRUN.
Prêt à mourir, donc ?...
ÉDOUARD.
Prêt à me battre !... un duel, où l’un des deux restera sur la poussière.
LEBRUN.
Un duel !... et, moi, je n’en veux pas !
ÉDOUARD.
Comment !...
LEBRUN.
Un duel, où des témoins viendront mesurer les épées, de peur que celle de l’époux outragé ne se trouve trop longue !... un duel, à armes égales, avec lui ! oh ! ce serait une dérision !... mais étaient elles égales, nos armes, alors que tu es venu m’attaquer dans ce que j’avais de plus cher, mon honneur et l’avenir de ma fille !... dans cette lutte, où j’ai apporté, moi, l’hospitalité et la confiance, et, toi, la lâcheté et la perfidie !... Un duel ! mais si le sort me trahit, et que j’en revienne blessé, ce sera une nouvelle honte ajoutée à la première ; on me montrera du doigt, en disant : il n’a pas même su venger son honneur, venger sa femme, morte déshonorée !... Oh ! non, non... il me faut ta vie !... il me faut une vengeance que je ne confie pas au hasard, parce qu’il n’est plus de hasard qui puisse me rendre l’honneur, à moi !...
ÉDOUARD.
Oh ! mais, vous n’oserez pas m’assassiner ! Songez qu’il y a des lois !...
LEBRUN.
Des lois qui me refuseront justice de ton crime !
GADICHET, en dehors à la porte du fond.
Maître, il faut fuir !... les voilà qui viennent vous arrêter, le constable, des gardes, et Murrai.
LEBRUN.
Murrai !... ah ! c’est ton arrêt de mort !... Murrai, la maison des fous, la prison, les tortures, une longue agonie ; et tu vivras, toi !... tu riras de mon supplice !... oh ! non, non ! Dieu doit m’absoudre !...
Il s’approche de lui, et le poignarde.
Scène XIII
ÉDOUARD, LEBRUN, TOUT LE MONDE, GARDES
MURRAI.
Édouard ! mort !... assassiné !
PETERSON.
Le malheureux !
JENNY.
Grand dieu, vous l’avez tué !...
LEBRUN.
Sa mort vous purifie ; vivez pour notre fille.
MURRAI.
Arrêtez l’assassin ! l’échafaud me fera justice.
GADICHET, se précipitant devant Lebrun avec force.
L’arrêter !... un instant, vous oubliez donc docteur, que mon pauvre patron est fou ?
MURRAI.
Lui !...
GADICHET, présentant le papier qu’il lui a enlevé.
Tenez, mon magistrat, en voici la preuve... la preuve que le docteur lui-même a rapportée de France !
PETERSON.
En effet, monsieur, cet ordre, votre déclaration, tout prouve la folie de cet homme ; la loi ne saurait l’atteindre !...
GADICHET, à Jenny.
Il est sauvé !...
JENNY, à genoux.
Sauvé !... merci, merci, mon Dieu !